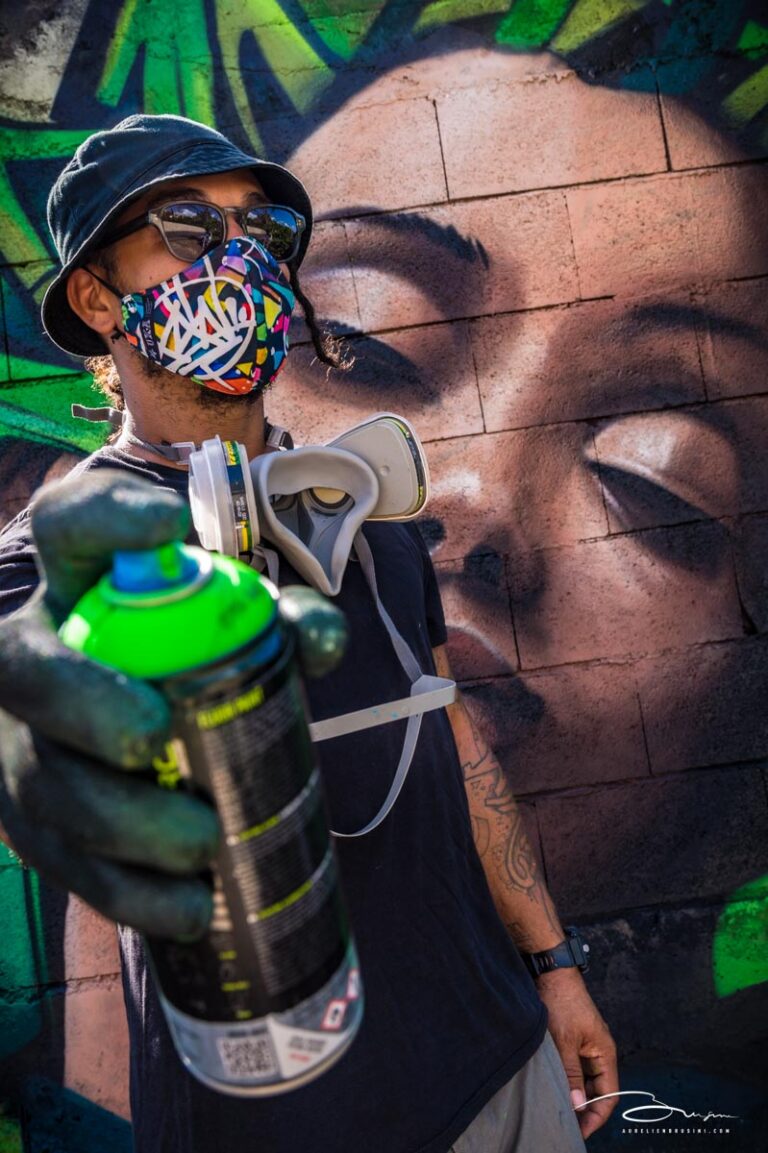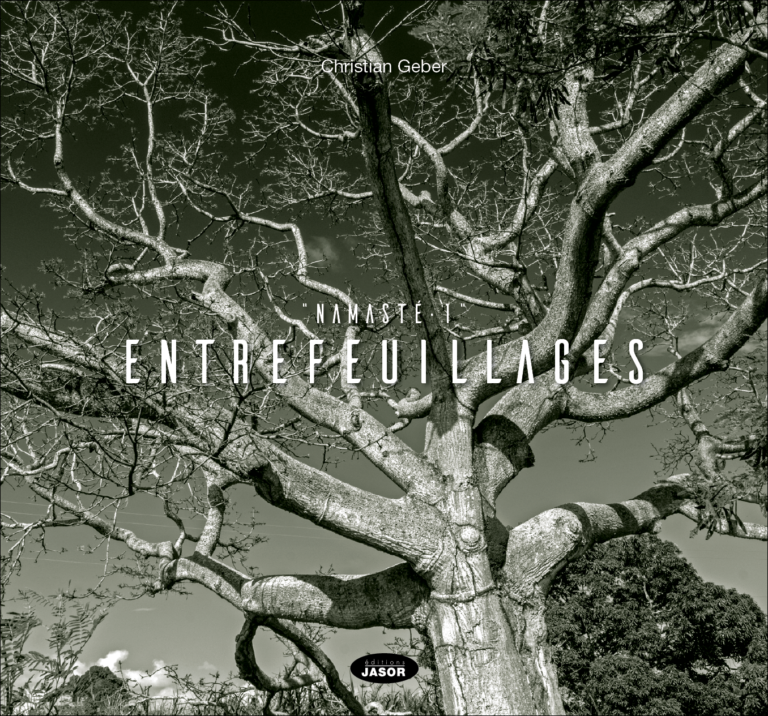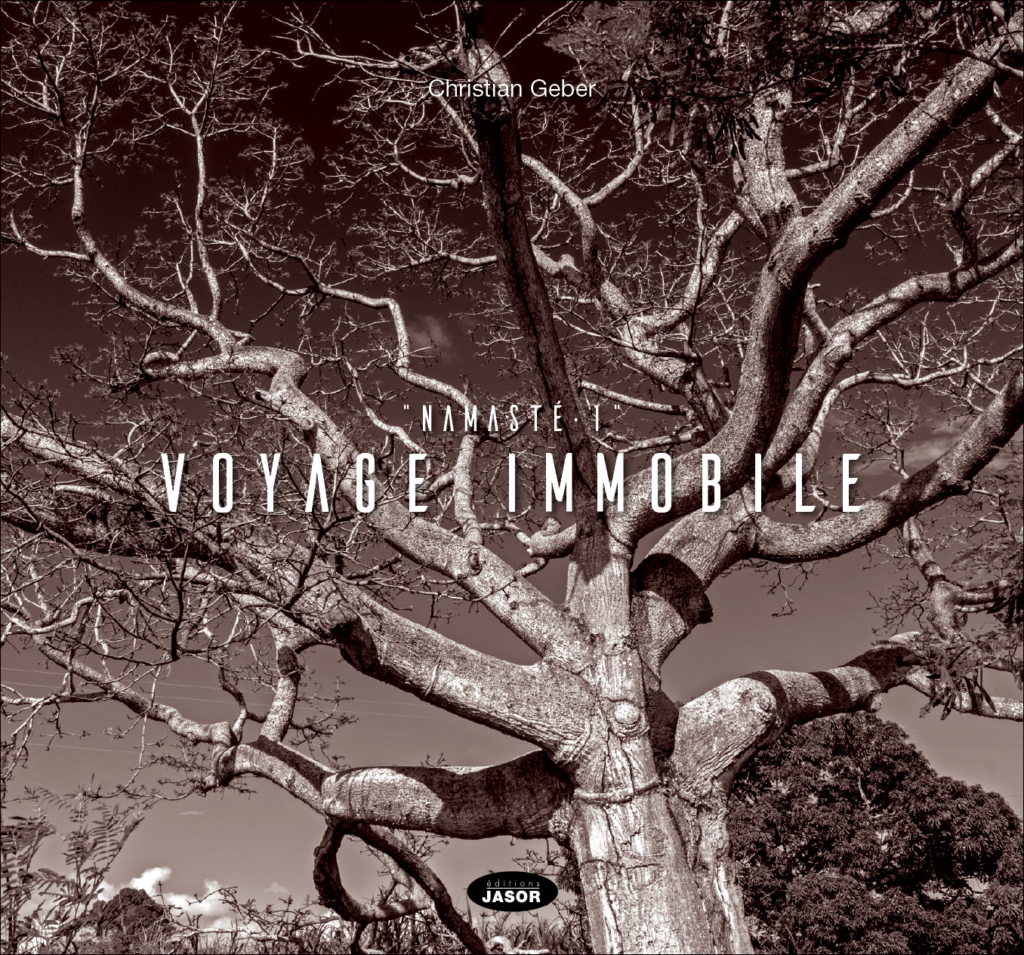Journaliste et musicienne, la Martiniquaise Marijosé Alie est aussi écrivaine, autrice entre autres des « Entretiens avec Aimé Césaire » parus en 2021. Dans les « Nouvelles de Martinique », textes hommages à l’île aux fleur, Marijosé Alie nous offre une histoire d’amour, drôle et délicieuse. Un bonbon littéraire.
Voilà ! C’était en train d’arriver, elle allait le quitter.
Il connaissait par cœur cette sensation d’une force terrible qui l’aspirait, vidait son corps de tous ses fluides, laissant une flaque nauséeuse sur le sol et les tremblements d’un chiffon de peau suspendu aux tremblements de sa carcasse… Depuis tellement de temps, il savait, il savait que ce moment était inscrit dans leur relation : elle tournerait le dos et partirait, l’oubliant là comme une crotte de chien sur le bord d’une route.
Normal.
Une femme comme elle ne pouvait pas s’accommoder bien longtemps d’un type comme lui, et déjà, déjà, Alléluia !, tout cela avait duré bien au-delà de ses espérances, même les plus folles si tant est qu’il en eût. Voilà, c’était maintenant, elle partait.
Au commencement, il ne lui avait prêté aucune attention, trop occupé qu’il était à apprivoiser la course que se livraient ses bras et ses jambes pour grandir hors de ses manches et de ses pantalons.
À l’époque, il traînait avec ses potes dans les ruelles qui se dessinaient au gré du bric et du broc de constructions aléatoires. Trénelle était une colline des miracles où une nuit, une seule, suffisait à faire jaillir de terre une case et des jetés de cloisons qui, en un rien de temps, abritaient une famille à rallonge.
Trénelle cascadait jusqu’au bord d’une frontière virtuelle qui délimitait le centre-ville, là où dormaient les bourgeois.
En fait de pote, il en avait surtout un, Ti-Chabin qui, comme l’indiquait son surnom, avait la peau, les yeux et le poil clairs, et sa tignasse crépue qui oscillait entre le rouge et la paille séchée était ce que Julius connaissait de plus sympathique dans le quartier… Julius, c’était son vrai prénom mais personne ne l’appelait comme ça, il était Julius dit Fil-de-fer, alias Filfè. Et il suffisait de le regarder pour comprendre.
Quand, finalement, ses bras et ses jambes furent arrivés au terme de leur course, sans victoire notable pour les uns ou pour les autres, il avait tout d’un kayali1 monté sur échasses et il cachait
la maigreur de cet attirail à l’abri d’un pantalon qui lui talonnait les chevilles et dans un débris de chemise qu’il retroussait au poignet ; comme cela, il avait un look bien à lui alors que tous les ados de son âge allaient torse nu et en short.
Non, en ce temps de grande liberté où l’école était une variable d’ajustement, il ne l’avait pas calculée ; ni sa peau de sapotille brûlée, ni son déhanché provocant – il n’existait pas encore –, ni son regard d’eau profonde.
Il faut dire que la préoccupation du moment était la fabrication d’arbalètes pour déboîter les canettes de lait et les bombes en fer blanc… Les compétitions organisées au bout de sa ruelle requéraient un tel savoir-faire que cela confinait au grand art et les « sachants » roulaient les épaules, respectés et recherchés. Ils étaient extrêmement populaires.
Car il fallait déjà trouver et tailler dans le bois tibonm3, le Y idéal et suffisamment solide pour résister à la pression du caoutchouc où viendraient se loger les projectiles. Le caoutchouc était fourni
par les vieilles chambres à air de pneus rechapés qui étaient l’objet le plus recherché à plusieurs kilomètres à la ronde.
Ensuite, tout était question de mesures et d’équilibre. Une bonne arbalète vous garantissait une vraie notoriété et une vie de rêve.
C’est un peu ce qui arriva à Julius ce matin de ses dix ans, quand il grimpa vers le glou-glou de la rivière-canal, son arbalète à la main, Ti-Chabin sur les talons.
Tous deux armés de leur engin avaient bien l’intention de décaniller quelques mangots qui les narguaient au sommet de l’unique manguier qui poussait comme un fou au milieu d’une véritable décharge domestique.
Peu importe, en plus ils avaient faim, c’était dimanche ; sa mère, comme une grande partie des voisins, avait couru à la cathédrale qui égosillait ses cloches tout en bas… Julius se préparait à un instant de pur bonheur qu’il ne partageait qu’avec lui-même. En parler à Ti-Chabin aurait été vain, il aurait ricané en vissant son doigt sur sa tempe ; mais Julius Fil-de-fer alias Filfè n’était pas fou, il savourait le moment où il irait s’asseoir face à la mer-horizon et déguster le jus sucré du mangot qui lui coulerait dans la gorge pendant qu’il regarderait s’agiter la vie tout en bas. Il ne saurait pas dire pourquoi mais la vastitude de la
baie gardée par le fort inutile qui s’ouvrait sur un ciel sans fin lui mettait de l’eau et des picotements dans les yeux.
Il était donc en pleine extase quand elle apparut, une petite chose chétive qui poursuivait un chien tellement pouilleux qu’il en était repoussant. Elle l’accablait de mots doux :
« Viens, viens, petit trésor, concombre de mon jardin, chou-choubi, viens voir Émilia. Je vais te donner plein de bonbons. »
Ti-Chabin, qui se prenait pour un beau gosse avec ses muscles précoces, ricanait :
« Tu es couillonne ou quoi, les chiens ça mange pas de bonbon, ça mange des os ! »
Elle le toisa, lui tourna le dos et repartit en courant.
Fil-de-fer n’avait pas pipé mot, juste il avait été alerté par l’éclat vert de son regard et puis ça lui était sorti de la tête… Non, il ne l’avait pas captée.
***
Il habitait avec sa mère derrière des parpaings badigeonnés de jaune qui faisaient leur fierté, juste à côté de la cabane en fibrociment nu que Ti-Chabin partageait avec une fratrie de chabins « tactés codinn », sous la houlette vibrante d’une mère hurleuse qui distribuait les claques avec une grande générosité.
Chez lui, c’était plus calme. D’abord, il n’avait ni frère ni sœur ; et puis, il y avait un monsieur qui se pointait de temps en temps, dont sa mère lui avait dit un jour sans aucune solennité particulière : « Voilà ton père. » Il se trouve que cet homme-là était arrivé serrant sous son coude une chevelure de plumes noires brillantes, surmontée d’une magnifique crête rouge qui s’agitait avec arrogance… Fil-de-fer n’avait fait ni une ni deux, il avait adopté son père et le coq dans un même élan d’amour sauvage et inconditionnel.
Au fil des visites du bonhomme, les chevelures à plumes avaient changé de couleur, parfois rousses, parfois brunes, une fois, une seule, blanche tachetée de brun… Il avait entraîné Ti-Chabin et suivi cet homme-père dans les hauts du quartier.
Une fois dépassées les cabanes, on arrivait à ce terre-plein de verdure où glougloutait une rivière- canal où Fil-de-fer et Ti-Chabin s’évertuaient à piéger les zabitan aux énormes pinces que sa mère refusait de cuisiner. Elle hurlait :
« C’est sale, ça mange la merde et y a rien à bouffer dedans ! »
Alors il s’était spécialisé dans le rôtissage de zabitan sur feu de charbon et il suçait les pinces avec Ti-Chabin, en chassant les gamins qui venaient se moquer de leurs maigres pitances… Et, ma foi, bien assaisonné avec piment et tout le tintouin, cela sentait plutôt bon ; d’autant que depuis que la municipalité avait aménagé un semblant de conduites d’égout, on n’avait plus à lutter avec l’odeur des excréments de tout le voisinage.
L’homme-père avait déplié son coude et caressait les plumes fauves d’un magnifique coq qu’il posa religieusement sur le sol. On avait déblayé le tas d’ordures au pied du manguier et tous les majors du quartier s’étaient donné rendez-vous.
Quatre coqs dont celui de Julius père étaient les vedettes de cette rencontre et Fil-de-fer n’était pas peu fier d’être là pour une attente excitante où les paris allaient tomber, où l’argent et le rhum allaient circuler, où commençaient pour lui et pour son pote les vraies affaires, les affaires d’homme.
Il observa comment le père fixait deux lames de rasoir aux ergots de sa bête, il essaya de contenir sa poitrine qui battait le tambour, il hurla avec les autres, il jubila quand son père empocha la mise, avala deux verres de rhum et se retourna vers la mer pour absorber un petit supplément de bonheur.
Et là, il la vit.
D’abord, il ne fit absolument pas la connexion entre la chose chétive et noiraude qui courait il y a peu en poursuivant un chien à puces de ses caresses et l’actuelle apparition qui lui crevait les yeux.
Mais comment ce corps malingre aux shorts trop larges sur des jambes grêles avait pu laisser échapper une silhouette aussi formidable ?
D’accord, elle avait toujours ce truc incongru, ces yeux verts profonds qui chahutaient son visage sombre… Mais là, alors là, il y avait des seins bombés comme des oranges vertes qui gonflaient un T-shirt ; et la chose la plus hallucinante, c’était ce derrière qu’on découvrait quand elle s’en allait et vous tournait le dos, somptueux, tellement somptueux qu’on avait envie d’y poser une bouteille de Lorraine4 pour voir si elle tenait debout.
Julius jeta un œil à Ti-Chabin :
« Tu vois ce que je vois ? »
Visiblement Ti-Chabin ne vit pas la même chose que lui car il continua à enfiler son rhum pendant que le ton montait entre les parieurs.
Quand les premiers coups partirent, Julius était suspendu sur un nuage qui s’effilochait à la pointe du fort Saint-Louis et rien n’avait d’importance. La fille agrippait le bras d’un homme, sans doute son père, qu’elle suppliait :
« Rentrons, allons, rentrons à la maison. »
Quand elle encaissa un coup de poing collatéral qui l’envoya au tapis, Julius sortit de son hébétude. Il moulina des bras et du torse avec une hystérie frénétique et se retrouva terrassé, la mâchoire déboîtée, la bouche en sang, dans la posture du héros gémissant avec, au-dessus de lui, le sourire plein de lèvres d’une créature de rêve qui lui murmurait des mots qu’il n’entendait pas tant les rires autour de lui était gras et tonitruants.
Julius se leva et cligna des yeux comme un manicou5 piégé par la lumière d’une torche.
Elle s’appelait Émilia et ce n’était pas de sa faute non plus si tout le monde la surnommait « gros bonda ».
De ce jour, ils ne se lâchèrent plus.
Il était son héros et même si l’on se moquait de la dévotion dont il l’entourait, il était plus fidèle que son ombre, attaché à chacun de ses pas, à chacune de ses respirations comme une tique sur un bœuf à cornes.
Au bout d’un temps qui laissa filer leurs années d’adolescence, le quartier avait fini par s’habituer à les voir ensemble, bavassant, se chahutant, se poursuivant, acceptant de loin en loin que d’autres humains pénètrent le cercle secret de leur complicité.
Dès le départ, Julius, qui avait des douleurs abdominales chaque fois qu’il la voyait, attendait le moment fatidique où elle le renverrait dans ses vingt-deux mètres. Quand elle penchait la tête et le dévisageait sous ses cils épais, il attrapait le rayon vert sous ses cils en se disant, le cœur explosant dans la poitrine : « Elle va me quitter, elle va me quitter. »
Mais elle était encore là quand il lui attrapa les mains pour lui voler un baiser ; elle resta quand il essaya de glisser ses doigts dans sa culotte, même si, au bout du compte, elle lui fit comprendre qu’il avait intérêt à occuper ses mains ailleurs.
Bref, les choses avançaient au rythme de la vie et Fil-de-fer se réveilla un matin avec la certitude qu’il était temps de concrétiser ses projets.
Il en avait deux : le premier était de mettre Émilia dans son lit, de la couvrir de félicité et de calmer le désir incessant qui lui brûlait les reins depuis des années.
Le deuxième était de nettoyer la place au manguier là-haut, et d’y construire un pitt7 dont il louerait l’utilisation pour des combats qui allaient ramener les coqs de tous les quartiers de Fort-de-France. Il se faisait fort d’organiser des tournois avec Texaco, Volga, Rive-droite8 et de se faire suffisamment de pognon pour jeter une aile supplémentaire à la case de sa mère et y installer sa reine, sa déesse, son tourment : Émilia.
Il s’attela donc à la construction de son pitt, conscient par ce biais qu’il coincerait la belle dans ses filets.
Nettoyer la place au manguier, récupérer du fric en jobbant chez les bourgeois, acheter des planches et le matériel pour raboter, clouer, aplanir, échafauder, cela lui prit un certain temps, quelques années durant lesquelles il ne participa à aucune réjouissance, aucune fête à rhum-tambour et coup de bekmè dont le quartier avait le secret ; même le carnaval ne le sortit pas de son labeur. Tout juste s’il accepta de mettre le nez dans le moteur de la vieille guimbarde qui pétaraderait le temps de deux tours de piste dans le déferlement des vidés…
À Ti-Chabin qui le harcelait, il répondait qu’il était occupé.
À Émilia qui se plaignait de ne pas le voir assez, il répondait qu’il était occupé.
À sa mère qui lui reprochait de la laisser seule charrier des seaux d’eau pour pallier les coupures qui asséchaient le quartier, il répondait qu’il était occupé.
Bref, il mit toute son énergie à la construction d’une arène bancale mais efficace qui allait drainer tous les amateurs de combats de coqs, tous les pagna propriétaires de merveilles à plumes, ce qui lui bloqua toutes ces fins de semaine où l’on se consacre en général à caresser la dulcinée qu’on a négligée du lundi au vendredi… Émilia ne disait plus rien mais en était arrivée à haïr le pitt, les coqs, les combats, le rhum, les soirées fiévreuses et bruyantes sous le manguier, avec la même ferveur.
Fil-de-fer la regardait et pensait : « Elle va me quitter », mais c’était plus fort que lui, son pitt était en train de devenir le centre de tout ; non seulement il gagnait beaucoup d’argent mais en plus il était le garçon le plus respecté des quartiers. Tout semblait lui sourire, il n’essayait même plus de glisser ses mains sur le cul affolant d’Émilia ; de toute façon elle ne voulait pas qu’il la touche. Elle acceptait des longs baisers pleins de langue comme au cinéma mais cela s’arrêtait là, et Julius ne savait plus très bien ce qu’il attendait. Il continuait à penser : « Quand j’aurai assez d’argent, je lui ferai une maison et des enfants. » Mais au fond il savait bien que ce n’était pas une question d’argent. Il n’était même plus obligé de jobber au centre-ville. Les billets de mille gonflaient ses poches, il s’était fait mettre une dent en or, il portait un feutre sur la laine moutonneuse de ses cheveux, une gourmette en or pur brillait à son poignet et même si Émilia refusait tous ses cadeaux, il la sentait impressionnée par son aisance.
« Elle va me quitter », disait-il à sa mère.
« Elle va me quitter », disait-il à Ti-Chabin.
« Elle va me quitter », se répétait-il à lui-même. Et puis un jour la catastrophe survint.
C’est un voisin, Raoul, qui travaillait à la régie municipale, qui l’attrapa par le bras alors qu’il descendait vers la ville pour examiner un coq fameux qu’on lui emmenait en douce sur le marché aux légumes.
Il avait déjà enfilé son chapeau et affichait son élégance de circonstance quand Raoul l’arrêta :
« Filfè, tu es dans la merde !
– Qu’est-ce que tu racontes ?
Il lissait sa toute nouvelle moustache en se disant qu’il récupérerait Émilia à la sortie de son travail du moment (elle faisait le ménage à l’ouvroir).
– La mairie, vieux, ils ont décidé d’augmenter le potentiel de logements du quartier… »
Raoul était comme ça, il avait le chic pour employer des termes obscurs sous prétexte qu’il
travaillait à la municipalité. Il se prenait pour un gros mordant.
« Et ça veut dire ?
– Ça veut dire qu’ils vont construire dans les Hauts. »
Le Raoul était excité, sa jalousie lui suintait par tous les pores de la peau et Julius n’y comprenait pas grand-chose.
« Et alors ?
– Ben ils vont casser ton pitt, vieux, pour y mettre des immeubles, des HLM. »
Là, carrément, Raoul jubilait et Julius haussa les épaules en s’esclaffant, c’était tellement invraisemblable, une blague de grincheux, là-haut ? La place au manguier de son enfance ? L’endroit magique d’où il regardait le monde ? Là où tous ses rêves s’étaient épanouis ? Là où Émilia lui était apparue ? HA ! ha ! haaaaa ! La blague était bonne, il partit donc à ses affaires et raconta l’histoire à Émilia pour lui montrer à quel point on enviait sa réussite et leur amour.
Mais Émilia ne s’esclaffa pas, ne lui passa pas la main sur le visage en lui disant des mots sucrés, elle lâcha sur lui une rafale de ses yeux verts qui lui tordit les boyaux.
« Elle va me quitter », pensa-t-il.
Elle tourna sa grosse bouche dans tous les sens, émit un gros tchiiiiip et lui asséna :
« Je vois pas ce qui te fait rire parce que c’est vrai et tout le monde le sait, la mairie récupère son terrain. Je te rappelle que les bouts de bois que tu as cloués dessus sont à toi mais pas le reste !
– Les bouts de bois ? Attends, attends. »
Fil-de-fer n’en revenait pas : ce qu’elle appelait les bouts de bois, c’était une magnifique arène bien propre, bien nettoyée, entourée de bancs disposés en cercles de plus en plus surélevés pour que chacun puisse jouir du spectacle, c’était une tablette amovible, s’il vous plaît, où il récoltait les paris avec un tableau noir subtilisé à l’école des Terres-Sainville lors d’une descente nocturne qui avait rendu les flics perplexes (on volait des tableaux noirs maintenant ? Il y avait de quoi se gratter la tête).
Le nec plus ultra se cachait derrière une épaisse cloison en bois de coffrage : le palais de ses locataires, les chambres grillagées, pourvues de mangeoires en boîtes de conserve, la demeure des vedettes, les coqs de combat dont deux qui lui appartenaient et avaient coûté une petite fortune… Le tout couvert d’un charivari de feuilles de tôle peintes en rouge madras, la seule couleur qu’il avait réussi à subtiliser sur un chantier municipal. Donc les bouts de bois n’étaient pas que des bouts de bois, c’était sa sueur, son sang, la nourriture de son âme, son rêve qui avait courbé son père-homme d’admiration et lui avait cloué le bec de louange et d’amour et c’était simplement somptueux.
Pour la première fois, il considéra Émilia avec méfiance et pensa : « Elle va me quitter », sans que son cœur s’emballe.
Il la regarda froidement du haut de son mètre quatre-vingt-dix et lâcha :
« C’est ce qu’on verra ! »
À partir de ce moment-là, on ne le croisa pratiquement plus dans le quartier. Il passa son temps à frapper à la porte de toutes les administrations du centre.
Il commença avec la mairie, attendit des heures, parfois des journées entières, sur les chaises de chaque service ; pas un cadre si minuscule et inopérant soit-il à qui il ne raconta son histoire : « Ma sueur, mon sang, un vrai travail, le rendez-vous des quartiers, une aubaine pour les marchandes de pistaches et de snowball qui étaient de plus en plus nombreuses à s’installer dès le vendredi soir, indémolissable, je vous dis ! »
Ensuite il attaqua les autres collectivités, le Conseil général et tous les cache-misère des fonctions territoriales, dans tous leurs bâtiments. Il en connaissait chaque couloir par cœur.
Le matin, il s’habillait de propre (il avait de grosses exigences sur le pli du pantalon qu’il réclamait à sa mère), il vissait son feutre sur ses cheveux crépus, lissait sa moustache et partait à l’assaut du dédale administratif qui se concentrait dans le centre de la ville.
À midi pile, il s’achetait une brochette sur la Savane, la faisait passer avec quelques gorgées de Lorraine et puis il reprenait son harcèlement.
Le soir, après la fermeture des bureaux, il allait traîner au bar de l’Impératrice, histoire, on ne sait jamais, d’y rencontrer un de ces Messieurs qui pourrait peut-être écouter ses arguments et les faire remonter à qui de droit, ensuite et seulement ensuite, à la tombée du jour (la nuit arrive tôt et brutalement sous les tropiques), il prenait le morne10, accablé de la lassitude de ses pieds et de son esprit et grimpait jusque chez Émilia.
Là, il la tenait sous la brûlure de ses yeux pour lui expliquer encore et encore que le combat de coqs était un patrimoine, un pan de la culture, ce que ses ancêtres esclaves lui avaient légué, le seul moment où, en temps longtemps, ils arrivaient à imaginer peut-être ce que pouvait être la liberté alors qu’ils étaient nés et mourraient enchaînés aux champs de canne ! Il trouvait les mots, un monument de paroles, et les esprits lui chauffaient la tête :
«Parce que, Émilia, tu comprends, ils y arrivaient, ils se cachaient, ils gagnaient, ils perdaient, ils nourrissaient les coqs avec un peu de leur sueur, un peu de leur sang pour en faire des tueurs… C’est ça que je fais, je les salue, je les entends, je les entends ! »
Émilia commença à considérer que son héros perdait la tête, elle prit un peu de distance et se mit à meubler ses samedis de sorties entre copines sous les tôles de la Pointe Simon où l’on guinchait jusqu’à l’aube et où l’on rencontrait tout ce qui voulait bouger le bas du dos à Fort-de-France, sans distinction de classe sociale.
D’autant que, les administrations étant fermées le samedi et le dimanche, Julius passait tout son temps à bichonner ses coqs, à préparer les tournois, à prendre les paris et à organiser les combats dans son maudit pitt, en s’arrosant largement le gosier, ce qui fait qu’il passait sous ses fenêtres au petit matin, saoul comme un bœuf.
Mais ce qui acheva la séquence et pulvérisa tout, ce fut l’affaire du palais de justice.
La veille il avait tenté la préfecture, dernier recours après avoir fait le siège des sociétés HLM qui n’avaient même pas daigné le recevoir.
« Qui, mieux que l’État ? », se disait-il.
Alors il avait obtenu un rendez-vous avec un cadre, grand fonctionnaire qui planchait sur des rapports concernant la sécurité publique et qui avait la particularité d’être un musicien surdoué qui affolait les soirées foyalaises de son piano endiablé. Il l’avait coincé à la sortie d’un punch en musique sous les tôles de la Pointe Simon et lui avait arraché la promesse d’une rencontre.
Il s’était donc assis face à son costume-cravate, après avoir été fortement impressionné par les grilles imposantes qui s’ouvraient sur son passage comme s’il était le président lui-même. Il avait beaucoup parlé, avec astuce, malice, diplomatie, commençant chaque phrase sur l’air du « Nous, les artistes qui savons faire revivre les temps anciens », censé envelopper le fonctionnaire d’une solidarité onctueuse et convaincante. Il était assez content de lui. Il avait les mots, l’autre l’écoutait sans l’interrompre avec quelque chose comme de la compréhension dans le regard, il allait y arriver c’était sûr ; pour la première fois depuis le début de sa quête, un souffle positif gonflait ses voiles, toute cette fatigue n’aura pas été inutile, se disait-il.
Quand il n’eut plus de salive pour porter ses paroles, il se tut et le fonctionnaire lui dit :
« Je comprends, je comprends tout à fait, mais cela ne relève en aucun cas de nos services, c’est avec la mairie qu’il faut voir cela ! »
Puis il s’était levé, avait fait le tour de son bureau pour lui serrer la main et lui signifier son congé, le laissant, invisible et désespéré, épave sur le trottoir.
Julius avait respiré un grand coup, considéré le décor qui l’entourait : à sa droite, la bibliothèque Schœlcher si baroque dans son architecture ; à sa gauche, le grand espace de verdure de la Savane où se pressaient les marchands ambulants sous les statues de Joséphine (de Beauharnais) et de D’Esnambuc qu’ils ne voyaient même plus, au bout, à l’extrémité du « Malécon », le fort Saint- Louis, dans le prolongement de la bibliothèque, l’hôtel-bar-restaurant-pharmacie de l’Impératrice où il avait essayé de rallier toutes les sommités de l’en-ville à sa cause… Au fond de lui, il y avait comme un grand cri fait de silence et de haine, de colère et de faim ; il prit sa décision.
Le lendemain, il arriva de nuit devant les grilles du palais de justice. Il avait emporté dans un grand sac à dos une bouteille d’eau, un cadenas et un serpent de chaînes métallique qu’il avait subtilisé à l’ouverture d’un chantier. Là, il s’arrima aux barreaux de métal du portail, consolida son cadenas, en avala la clé et attendit le lever du soleil.
Il resta trois jours et trois nuits enchaîné, à réclamer justice, avant que la police dont le commissariat gisait tout à côté ne vînt couper ses chaînes et le sortir manu militari pour le ramener chez lui. La mairie dans sa grande bonté avait œuvré pour qu’aucune poursuite ne soit engagée pour « désordre sur la voie publique », étant entendu que tout ce qui était attaché à un quelconque bureau dans la cité était parfaitement au courant du dossier Filfè, et pensait qu’il méritait indulgence et précaution, même s’il était le plus chiant et le plus têtu des citoyens de la ville.
Tout aurait pu s’arrêter là, sauf que pendant ses trois jours de grève de la faim et de la civilité, en plus des foules qui s’attroupaient autour de sa carcasse vitupérante, il avait reçu quatorze fois la visite d’Émilia. Au début, elle avait essayé les mots doux pour lui dire à quel point elle comprenait sa douleur mais qu’il ferait mieux de se détacher et de venir avec elle soigner une blessure que personne d’autre qu’elle ne pouvait guérir.
Ensuite, elle s’était un peu emportée, lui expliquant vigoureusement qu’on ne pouvait pas se mettre dans un état pareil pour un pitt qu’il pouvait bien ma foi reconstruire ailleurs.
Puis elle avait explosé, le traitant de sale égoïste petit bras buveur de rhum qui portait atteinte à sa dignité à elle en s’exposant à toutes les moqueries, non seulement du quartier qui venait déambuler dans l’en-ville pour ne pas perdre une miette du spectacle, mais carrément de toute la ville qui se gaussait de cet hurluberlu qui se mettait la rate au court-bouillon pour un truc aussi nul que des combats de coqs.
Il la regardait sans prononcer une parole, attendant qu’elle s’en aille pour un moment de grand plaisir qui consistait à mater son au-revoir de derrière qui persistait à l’affoler.
Et toujours dans sa tête la rengaine : « Elle va me quitter, elle va me quitter. »
Bref, l’apothéose fut atteinte au jour déclinant, le troisième, alors que chacun rentrait chez soi en lui jetant un œil amusé (on s’habitue vite, et il commençait à ne plus être d’actualité), dans un débordement de larmes et de cris entrecoupés de jurons très salés : Émilia, dans une représentation époustouflante de la femme bafouée et humiliée, conclut en tournant les talons par un : « Tu ne reverras plus jamais même pas mon ombre. »
Définitif.
***
De retour chez lui, Julius ignora avec dédain les regards de commisération qui traînaient sur son passage, il se mura dans un silence offensé que même sa mère n’arriva pas à briser.
Il faut dire qu’il avait tout perdu : son job, ses coqs, la femme de sa vie, le respect du quartier.
Quand une âme charitable vint lui expliquer qu’Émilia était partie dans le sud avec un vieux Blanc qui lui permettait de réaliser son rêve en achetant un restaurant de bord de mer, il prit ses cliques et ses claques, traversa une dernière fois la ville au tomber du soir, et alla pisser sur le fort Saint-Louis.
Là, dans la pénombre, il lâcha toute l’eau de son corps en larmes épaisses et bouillonnantes. Qui l’aurait vu aurait craint pour sa vie tant il beuglait sa détresse jusqu’à ce que sa gorge ne puisse plus émettre un son.
Ensuite, il s’endormit sur le sable.
Au matin nouveau, il resserra la lanière de son sac à dos, se frotta les yeux et grimpa vers le carénage.
Sur le port, il rencontra le patron du syndicat des dockers à qui il avait fait gagner des mille et des cents avec un coq qu’il lui bichonnait au petit poil.
L’homme était puissant, dans tous les pays du monde les dockers sont puissants, mais sur une île comme celle-là, ils le sont particulièrement. Ils ont le pouvoir de bloquer l’économie tout entière avec cinq mécontents qui stoppent l’entrée et la sortie de tout, de tout…
C’est ainsi que Julius se retrouva docker, gagnant bien, accrochant des muscles à sa longue carcasse, retrouvant le respect et l’admiration du quartier qui adorait les histoires où le héros se relève du canal où on l’a jeté pour décaniller tous ceux qui l’ont entravé.
Sauf que Julius ne décanilla personne, il faisait silence sur tout ce qui avait été sa vie d’avant.
Plus de coqs, plus d’Émilia.
Il n’en parlait même plus du tout et Ti-Chabin avait appris à fermer son clapet sur toutes les questions souvenirs.
D’ailleurs, tout le monde fermait son clapet.
***
Trois années passèrent ainsi. Julius, que plus personne n’appelait Filfè, prenait du gras et de l’importance, il montait en grade sur les tréteaux de la lutte, qu’elle soit politique ou syndicale. Il parlait bien et osait des digressions culturelles anecdotiques qui faisaient de ses discours des morceaux d’anthologie qu’on se repassait et qu’on remâchait dans les réunions, meetings ou manifestations… Quand la mairie vint le chercher pour lui proposer une place sur les listes électorales, il demanda à réfléchir.
Il s’enferma dans sa maison après avoir embrassé sa mère qui pétillait d’énergie depuis que son fils était aux affaires, alluma une bougie sur la table de la cuisine, éteignit les lumières et se mit à fixer la flamme vacillante.
S’il acceptait d’entrer en politique, il irait au bout de cette autre vie et il marierait la Zelga qui l’accueillait à bras ouverts entre ses draps depuis quelque temps. Elle était gentille, aimante, un peu maigre avec des omoplates plus imposantes que ses seins et un petit derrière bombé mais elle l’aidait à comprendre dans quel monde il était capable de vivre, elle le poussait à envisager demain, après-demain, toutes ces choses qui insultaient ses souvenirs… Elle l’aidait.
C’est donc dans ses bras qu’il apprit la nouvelle.
Le regard sombre, enfermé dans sa tête qui ne lui avait encore soufflé aucune réponse à donner à la mairie, il entendit des bouts de phrases :
« Viré son vieux Blanc… Le bougre est parti rejoindre sa femme mariée et ses enfants dans le Limousin… Il avait femme et enfants, quelle crevure… Une lettre dans ses affaires… Émilia… trouvée. »
Pendant tout ce temps passé à construire une autre vie, Julius avait refusé ne serait-ce que de penser à Émilia. Sa gueule se fermait comme une porte de prison quand quiconque tentait de donner de ses nouvelles.
Il avait tout perdu. Il ne lui restait que sa dignité qui s’épanouissait parfaitement bien dans le silence de son esprit et de son cœur, sauf que là, le malheureux cœur pompait, pompait, comme un dingue et l’asphyxiait à chaque mot prononcé par Zelga.
Il fallait qu’il sorte, qu’il ouvre la porte, qu’il avale une grande goulée d’air… Dehors, un tambour solitaire rythmait la nuit, pas une étoile, juste un ciel plombé de nuages opaques, la pluie arrivait. Il se répéta :
« La pluie arrive. »
Puis il enfila ses vêtements, sortit de ce lit pour toujours et prit le chemin du sud. Il avait vingt- sept ans.
Dans le taxico qui le conduisait à la pointe de l’île, il réfléchissait en absorbant les subtils changements du paysage.
Le sud était à peine à trente kilomètres de la capitale. La distance importait peu car il était évident qu’on allait vers autre chose. Plus aucune plante grasse ne poussait et l’horizon était nu, à peine quelques mornes pelés qui accueillaient de maigres touffes de cocotiers ou de prunier qui résistaient au carême.
Julius aimait le sec du sud qui donnait à la mer une saveur particulière.
Il ne savait pas bien ce qu’il allait dire à Émilia. Peut-être rien, après tout.
Pourquoi mettre des mots sur une évidence ?
Il avait eu beau la chasser pendant toutes ces années de son esprit, de ses conversations, de ses préoccupations, elle avait habité, squatté, envahi un endroit au milieu de son corps, là où battait son sang, à l’orée de son ventre, et tout le temps, tout le temps, elle y avait laissé plantées ses griffes à faire mal, à faire pleurer, à faire chanter, à le rendre fou.
Maintenant, dans la voiture qui filait vers le sud, il se laissait bercer par le murmure et les éclats de voix des passagers et savourait sa délivrance : les griffes avaient lâché son sternum et, lui semblait-il, lui chatouillaient le dos.
Ce fut facile de trouver son restaurant, elle y avait mis son prénom en enseigne avec juste cette précision : « Le meilleur blaff du pays. »
Au sortir du taxi qui l’avait déposé à la gare routière à l’entrée du village, il avait amélioré sa tenue. Il avait l’air un peu trop de la ville avec ses chaussures et son feutre sur la tête. Alors il avait ôté ses souliers, les avait glissés avec son chapeau dans sa besace puis il avait attaqué la rue principale pieds nus.
Un chapelet de maisons en bois de chaque côté de la chaussée. Au milieu du bourg, il vit l’enseigne.
Il était arrivé.
Une maison basse, tournée vers l’océan. De la rue, il ne voyait pas du tout à quoi pouvait ressembler le restaurant, mais il avait bien l’allure d’un rêve réalisé, et franchement cela se respecte.
Alors Julius s’assit sur le trottoir d’en face et attendit. Il était midi, il vit entrer et sortir des grappes de familles, de gens qui riaient aux éclats, qui chahutaient, ou alors repus et silencieux comme en religion avec leur digestion ; il était évident que l’affaire d’Émilia marchait du tonnerre de Dieu… Il attendait.
Elle ne pointa pas son museau, pourtant, évidemment, on avait dû l’alerter, la prévenir de la présence d’un monsieur « qui-n’était-pas-d’ici », installé sur le trottoir face à son établissement, et puis, évidemment, le téléphone-milan-point-com avait dû fonctionner à toute allure, les copines du quartier avaient dû appeler Émilia pour lui signaler avec des trémolos dans la voix qu’il avait disparu de Trénelle, qu’on ne savait pas où il était et bla et bla… Et fine comme une mouche, elle avait dû pressentir qu’il était venu vers elle.
Donc, il attendait.
Il attendit deux jours et deux nuits.
Le matin du troisième jour, à l’aube naissante, alors qu’il émergeait d’un sommeil paisible, recroquevillé sur un bout de plage qu’il avait délimité de ses hardes et de son chapeau, il la vit. Elle lui apparut à contre-lever du jour, descendant les marches d’une véranda où s’alignaient les tables bien rangées qui espéraient déjà le client. Il respira à pleines narines l’air épais qui sentait le sel, la mer et les algues, il respira la marée qui découvrait le sable humide.
Une éternité de plage se déroulait jusqu’à l’infini de son regard. Il n’y avait pas âme qui bouge à cette heure dans cette partie du monde, seulement elle, lui, et le silence de leurs retrouvailles.
Il se sentait sale et puant.
Et quand elle ouvrit grand les bras pour le presser contre son corps, il pensa immédiatement : « Elle va me quitter, elle va me quitter… »
Cette idée incrustée dans son cerveau rythma les années qui suivirent.
Rien ni personne ne put l’en déloger, même pas ce quotidien partagé qu’ils poussaient ensemble.
Il apprit la mer pour lui ramener les poissons choisis qui faisaient la réputation de son établissement, il apprit son corps dont son imagination n’avait pas su anticiper la densité de la folie, il apprit à mourir vingt-huit mille fois entre ses seins, il apprit à lui faire des enfants et à les aimer sans que cela enlève une once de la passion qu’il avait de sa peau, de l’insondable clarté de ses yeux, de ce cul somptueux qu’elle promenait entre les tables sous l’œil envoûté de tous les hommes mais aussi des femmes assis à ses tables, il apprit à tenir bien serrée entre ses mains sa tête couverte de nattes pour y poser des baisers délicieux et toujours il se disait : « Elle va me quitter, elle va me quitter. »
Jamais ils ne parlèrent de ce qu’il avait laissé au quartier là-bas.
Jamais ils ne parlèrent de coqs, de pitt ou des discours enflammés qu’il tenait sur les tréteaux de l’en-ville.
Une fois, une seule, il fit un voyage vers Trénelle juste pour voir ; il venait de poser à l’avion la petite dernière qui partait faire ses études au Canada. À la sortie de l’aéroport, au lieu de filer à droite du carrefour, il bifurqua à gauche vers Fort-de-France.
Quelques kilomètres, et il y était.
Il surplomba longuement la ville qui s’étalait jusqu’à la mer autour de la cathédrale, puis finalement il fit demi-tour.
Rien ne l’attendait en bas, sa mère était depuis longtemps partie rejoindre les étoiles et son enterrement avait été un passage brumeux, de la maison jaune au cimetière des pauvres, dont il n’avait gardé que le chagrin.
Il fit demi-tour et la vie continua son chemin.
Il avait ses habitudes, ses « habitudes de vieux » disait Émilia. Il installait sa chaise longue près du puits qui jouxtait la cuisine. C’était sûrement l’endroit le plus frais de la maison, d’où il avait à la fois une vue imprenable sur l’agitation du restaurant qui courait jusqu’à la mer et la place du roi pour attraper les odeurs magiques qui s’échappaient des fourneaux. Après avoir bataillé avec l’océan avant même que le soleil s’arrache de l’horizon, il laissait dormir ses yeux lors de siestes salvatrices.
Parfois, il soulevait une paupière sur le passage d’Émilia avec son cortège de rires, de fesses et de déhanchés qui lui nouait les tripes et lui brûlait encore les reins.
Quand Émilia se plia sur une douleur inconnue dans ce ventre qui avait porté quatre enfants, il l’accompagna à l’hôpital, mit de l’ordre dans leurs affaires, délégua la gestion du restaurant à leur fils aîné qui était de passage et qui « n’avait pas l’intention de s’incruster » (Tu comprends papa, les affaires m’appellent à Monaco et le prince adore ma cuisine – c’était à peu près ça en gros), et batailla avec les services administratifs pour qu’ils acceptent qu’il dorme avec elle et lui tienne la main nuit et jour.
***
Il en était là en ce jour d’aujourd’hui. Il regarda sur le lit ses cheveux blanchis, passa la main dans la laine noueuse des siens. Têtes blanches, c’est ainsi qu’on les appelait maintenant et il pensa :
« Elle va me quitter, elle va me quitter. »
Quand la chambre se meubla de silence, quand il comprit que le murmure de sa respiration était parti, il s’approcha encore davantage, perdit ses yeux dans l’opacité des siens, dans ce vert éteint qui se repliait sur lui-même.
Il se leva, tituba, lui ferma les paupières et c’est alors qu’il sentit une folle énergie lui parcourir le corps. Il savait exactement ce qu’il allait faire.
Il en avait des picotements au bout des doigts et des orteils, une rumeur pleine d’allégresse lui remplissait la tête, un orage de tambours pulsait dans sa poitrine.
Il lui caressa les joues suivant le dessin de son sourire.
Sa main connaissait par cœur tous les chemins de son visage et de son corps. Il lui rendit son sourire: «Tu me quittes mais je sais, je sais exactement ce que je vais faire. »
Il allait vendre le restaurant, oui, voilà…
Et avec l’argent il allait acheter ce pitt majestueux qui le narguait sur le bord de l’autoroute.
Un déferlement d’eau lui inondait le visage, il allait faire cela.
Et tout de suite.
Il tourna les talons, s’accrocha au fauteuil qui avait accueilli son grand corps fatigué pendant tant de jours et tant de nuits. Il s’y assit doucement, un frémissement sous le déluge, et ferma les yeux : il fallait qu’il se repose un peu avant d’aller mettre son grand projet à exécution. Il ferma les yeux dans un grand sourire.
Et c’est ainsi que mourut Julius Grandorvan, dit Fil-de-fer, alias Filfè, persuadé qu’Émilia le quittait enfin et qu’il allait acheter le pitt de ses rêves, perché sur le morne Acajou au-dessus de l’autoroute.